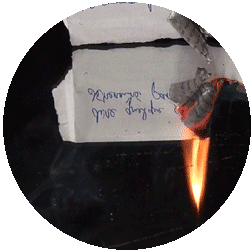-
Rester
J’ai vu les reflets de ses grandes rues nouvelles, aux plâtres frais, aux couples neufs, aux larges trottoirs. J’ai cherché les rues cachées et j’ai trouvé, les étals, les enfants, les ordures, les attroupements et la vitesse, le bourdonnement. Sans m’arrêter, une marche qui sait où elle va, sans moi, mais des pas qui vont. La peau qui fuit en dedans devant les regards. La faim qui cherche, rapide, sur les marchandises en désordre. Et c’est la grande fatigue de cette angoisse solitaire, le renoncement, la fin. Les vomissements, les boyaux qui se vident, cachée de la rue dans la petite pension déserte, en plein jour et un peu au frais des murs, derrière. Plusieurs jours, écouter les bruits de cette rue, dans ce port, dans cette île, écouter cela seulement, voir cela seulement, le balcon et le linge qui y sèche, cette rue seulement vue de cet étage. La façade ocre décati en face, grande plage gondolée de bas en haut, les pétarades des mobilettes, les groupes de jeunes hommes en bas. Plusieurs jours et plusieurs heures, avant de reprendre le ferry, plusieurs jours ici sur ce lit et ces draps blancs, qui absorbent les odeurs de mes transpirations. Le mur à droite de la fenêtre, blanc, la chaîne de métal, le blanc de la peinture, décollé dans plusieurs années. Le matelas creusé, l’oreillé dur. Un piano au loin dans les habitations en face, et en haut un balcon et toutes ses plantes vertes. Je demande à rester encore une nuit, je reste, là encore un peu, les dernières heures, la dernière fois, ici, les autres places et les autres rues sont derrières, avec des mariages en blanc et en noir, cadillac, ici, il y a la rue qui finit et le piano qui n’en finit plus. Je me recouds, assise sur la chaise en bois, assise sur le lit, glissant, glissant, couchée, j’accroche à peine les notes du clavier, à peine, elles affleurent, me persuader qu’il joue, me persuader que j’ai vécu. -
Longer
L’île promet d’être belle au bord de son eau. Le bus va sortir de la ville. Selon la logique, il devrait longer la côte. Il traverse des bois de dune, les chemins de croisée me font soudainement face, et j’y vois une femme au fond. Je cherche la trace du véhicule qui l’aurait transportée là.
Trois garçons ont leur serviette jetée sur l’épaule.
On voit ensuite la mer toujours à droite et donc je vais vers l’ouest. D’un point de vue global. Il est possible que dans l’anfractuosité éventuelle je sois face au nord ou au sud.
Je tente de reconnaître les signes apparents et visuels d’une plage agréable. La route est grosse.
Les zones résidentielles.
Je suis aux aguets pour le lieu que je voudrais. Avec l’appréhension. Je ne le verrai qu’une fois derrière mon dos.
La longueur parcourue s’emmagasine en moi.
La salle de bain / Rome aussi est belle/ érotique / vu des corps comme rinçables / la peau plastique étanche
-
Gravir
Tu es seule ?
Oui.
Tu vas monter jusqu’en haut ? Le car ?
Oui. Non, à pied.Elle me prête son pull. On ne pense pas assez qu’un volcan est une montagne, qu’il y fait froid. Le froid du vent. Son pull est fin. La douceur des collines enchâssées qui font le mont. Le froid du vent. La vitesse des brumes. Une mer de brume en grand courant sur les sables gris, sur la cendre, seulement la cendre. Les brumes vraiment des vagues. Comme sur l’autre, quand on voit au loin le bouillonnement. Je le fixe le plus intensément possible, imprimer une persistance rétinienne. La persistance n’obéit pas à la volonté, des années après.Le chemin large pour les engins forme un ruban plat qui coupe le flanc. Une terrasse qui déroule ses virages impassiblement, l’un après l’autre. Au tournant se dévoile le tronçon suivant, et l’autre virage là-bas. Les flancs sont rocheux, des bouillonnements figés qui ne laissent qu’une possibilité : le gris. Un gris attiré vers le noir, et sur quelques zones vers la rouille. Le chemin large creusé se déroule. Il n’y a qu’elle et moi sur la route, elle est parfois devant, dans mon champ de vision, et c’est parfois moi qui occupe le sien. La zone de l’entre-deux finit par être atteinte. Comme une piste de ski, mais gris et déserte. Les filets de brumes accourent vers nous, venant d’en bas. Ces vents ne sont pas qu’air et commencent à être souffre. Le souffle essoufflé de la montée et de l’effort s’empoisonne de souffre indispensablement aspiré. Une petite dose, d’abord. Les jambes ne s’arrêtent pas, car il y a un sommet à atteindre. La journée pour cela. La dose augmente, doucement, au fur et à mesure que le souffle se fait plus court, plus avide, la dose augmente. Une angoisse pointe sous la fierté de monter avec les jambes, de monter pour sentir les étapes, le dénivelé, les variations. Une angoisse qui ne sait pas quelle dose atteindra ce souffre, qui ne connaît pas la distance ni l’effort encore à fournir. Un air de souffre qui affirme la nature des lieux. Un air qui nous cloue.
Un plat désert se forme, enclave, région insoupçonnée d’en bas, d’en haut, secret et oasis de poussière au creux. La douce zone entre-deux, la zone de battement. Bien plus étendue qu’ailleurs, un plateau.
C’est là que le désert de souffre et de cendre se déploie.
Il a encore, comme des marécages, ces étendues à traverser, pour aborder si on en sort un autre flanc à gravir.Sommet. Le sommet n’existe pas. Quelques crêtes autour de vasques de couleurs, fumant.
Automatismes. Ouverture des portes, laisser sortir avant de monter s’il vous plait, se caler su le côté, l’angle, le tranchant de la porte, dernier passager, élan, regard droite-gauche sièges libres. Viser. S’asseoir, ne pas regarder son voisin d’en face trop dans les yeux. Deuxième, sortir, escaliers, monter, couloir, descendre attendre. Sonnerie de porte, monter, trop de monde, attendre debout d’arriver.
Je tiens de ma main gauche la barre raccordée au mur, dans le sas où coulissent les deux rames. Les plastiques s’emboîtent pour épouser les virages. Entre flanc gauche et dos contre la paroi ; le sol pivote, au calme, dans le roulis. En face de moi, il tient la barre de sa main gauche. Entre flanc gauche et dos contre la paroi. Tous deux en symétrie les pieds sur le même sol. Les virages font varier la distance entre dos et main. Le bras s’étire et reprend son pliage, de façon symétriquement opposée entre lui et moi. Abandon du corps avec cette main, et ce dos adossé, et le tout pivotant. Après trois stations, je décolle. La main lâche, petit coup du dos pour mettre le corps en marche. Lui, à la même seconde, même mouvement, nos corps après trois pas se heurtent, au centre exactement, il passe, nous sortons jamais plus revu. -
Descendre
Vallées, vallons, le bus s’arrête, je descends, il ne reste personne. Le chauffeur tente de m’expliquer où se trouvent les gorges, mauvaise communication. La petite route à gauche, celle qui descend, qui s’éloigne de la route-cime. Virage sur virage, vignes, prés, objets abandonnés, rocailles, une bâtisse avec ses chiens de garde.
Quand on descend, on marche vite, les jambes lancées, l’action c’est de rattraper le corps, on joue avec le poids, l’attraction terrestre. Si ce n’est pas la bonne route, il va falloir remonter, impossible. Soleil. J’ai oublié de prendre un chapeau, ou un foulard, les cheveux brûlants.
L’hésitation, de temps en temps une voiture, je lève le pouce. Une étrangère, ça saute aux yeux. Montrer un visage tout-va-bien. Tout va bien, c’est le début de la journée, il reste beaucoup d’heures pour agir.
Quand une voiture s’arrête, je le regrette presque, un vieil homme seul, regard de travers. Il me parle de ses enfants. Vieux outils qui traînent dans la voiture, blanche, une petite camionnette. Je crois qu’il ne regarde pas assez du côté de la route, ses lunettes collent de saleté.On roule, j’y aurais passé la journée si j’avais continué à pied. Toujours en descente. Un village soudain devant lui et devant moi. C’est là, c’est là, il pointe du doigt. Au revoir, merci et bonne journée.
De quel côté ? Je prolonge dans la même direction, petit chemin humide. Trouver l’eau, trouver son bruit. Le chemin s’effiloche, peu de chance. Je reviens sur mes pas. Un autre, marcher, être patiente. Oui, je vois, des voitures garées, une aire faite pour ça. Sorte de hutte qui nous dit que c’est là. Des familles quittent leur voiture, pique-nique, couvertures et maillots de bain. Suivre le flux, déjà éparpillé. La route est de sable, large, chemin aménagé. On ne descend plus. Voici l’entrée du tunnel qui mène aux gorges.Ce tunnel semble tout frais. Tout frais construit. Les chaussures des petits groupes qui vont vers leur journée de détente au bord du torrent crissent sur le gros sable de la route. Des fuites de temps à autre, un tunnel très peu authentique, fait pour les nouveaux touristes.
A l’autre bout, la chaleur m’écrase. La route s’étrécit. Elle longe le flanc d’un mont gauche. En contrebas, le torrent, inaudible et invisible d’ici. Encore plusieurs mètres et la route abandonne ses velléités touristiques. Devient plus accidentée. En descente, et on a accès au torrent qui passe. Des criques reposent l’eau et c’est là que les familles choisissent de s’installer. L’eau est dense et froide mais le soleil chauffe l’enclave comme un four.
Jaune craie, ocre pâle, la roche, peu de végétation. La verdure entoure le torrent comme des poils un sexe. La roche est polie et creusée, il y a des grottes. Je cherche l’endroit ou me reposer, me baigner. Chercher la pierre plate accueillante, cachée, au bord d’un creux d’eau un peu plus large. Pas trop près des familles, pas trop isolé.
Là, il y l’endroit parfait. Mais comment s’arrêter là ? La vallée est longue. Je n’ai pas vu encore les tombes troglodytes.
Ils pouvaient escalader habilement les parois. Les Anasazis étaient ici. Vivaient de chasse et de cueillette, cultivaient des légumes et des fruits sur les étroits coteaux.
Le chemin joue un jeu d’amour avec le torrent, venant le caresser puis s’éloignant haut dans la paroi, passant dans les infractuosités de la roche. Je cherche les ruches préhistoriques dans le flan opposé, me trouant les yeux, croyant être aveugle. Bientôt, elles apparaissent, les cases, nettes et précises, évidentes, en altitude.
Les promeneurs d’aujourd’hui ne peuvent pas y monter, ils restent sur leur chemin à les imaginer de plus près, leurs plafonds bas, leurs nivellements : cette roche bossue était une table. Leurs lits en creux.
Voilà les troglodytes. Une trentaine de petits trous dans la roche, là haut. Vu d’ici, en contrebas, dans le four.
La bête me pousse et mon pas est rapide. Le chemin passe de l’autre côté du torrent. Les vergers apparaissent, en rangées, plantés là sur d’étroites surfaces approximativement planes. A ce niveau de la vallée le chemin s’est élargi à nouveau, il peut permettre à d’éventuels véhicules d’accéder à l’enclave. La zone de loisir est derrière moi. Pourtant bientôt une aire de pique-nique, fantomatique, de ces fantômes vaporeux et brûlant, de ce délire de transpiration. Tables rondes en pierre, encerclées de bancs solidaires, en pierre eux aussi. Plus d’une heure déjà que les babillages des plaisanciers sont étouffés par la distance et les replis de la roche. Quand et où finit cette vallée ? En ressortir à l’autre extrémité. La soif me tiraille devant l’eau qu’il ne faudrait pas boire. Il ne faut pas, concentrée sur le goût de la rivière pour ne pas m’empoisonner. Sur son lit, galets et cailloux. Je cherche un galet lisse. Je cherche un coin un peu plus caché par les arbres. Je cherche un creux.Il est temps pour, ailleurs, un moment de baignade, pour y penser, aux possibilités de retour à l’hôtel,
Des points noirs, gonflés, dans les buissons, les ronces, des mûres. Leur goût comme un bijou. Je suis survivante ici, seule, avec ces mûres. Chaque saison son fruit. Je fabriquerais une canne à pêche. Peut-être même un arc pour chasser.
Ce lieu pour disparaître.
Sur le retour, une grande pierre au-dessus d’un bassin. S’enfoncer dans l’eau progressivement. Son froid dense presse, mordant. Puis, le corps habitué, grimper sur la roche et sauter, s’engloutir brusquement. Plusieurs fois. La crique est profonde, on voit jusqu’au fond, un poisson.
Le corps verrouillé, une angoisse sourde dans la nuque.Je suis là un élément indépendant et séparé dans ce décor, et surtout sans moyen de transport, cet handicap faisant de moi une chose importée, un collage.
Je guette l’heure de départ des villégiateurs, seul espoir pour moi de rejoindre le village le plus proche, peut-être un bus. Les quelques familles semblent s’être donné le mot pour évacuer la zone, et dans un mouvement migrateur je les suis. En marchant, j’observe les différents petits groupes, jaugeant mes chances de monter dans leur carrosse. Tel troupeau est trop nombreux : un couple et quatre enfants, il n’y aura pas de place pour moi. Tel autre s’effraiera : deux vieux très méfiants. Arrivés à l’aire de parking, où attendent, bien rôties, les quatre ou cinq voitures, tout va très vite, les marmots embarquent, le père fait tourner la clé. Dernière chance précipitée, tentative d’approche d’une dame, qui sera bienveillante, il faut l’espérer. A force de mauvais accent anglais, de mots-clés italiens et de gestes embarrassés, elle comprend enfin que j’aurais bien besoin d’un tour en voiture.Me voilà embarquée avec un couple grisonnant et leur fils ado attardé, lubrique et bourré de tics.
La proie que des parents sadiques et incestueux voudraient offrir à leur fils psychotique.L’hôtel est en périphérie de Syracuse. Proche de la gare routière, les chambres sont les moins chères que l’on peut trouver. Entre mon lit et le lavabo où je lave les tomates du dîner, il y a cinquante centimètres. Un liseré de carrelage vert borde cet espace délimité, espace d’eau. Il y a la fenêtre qui donne sur la cour, en vis à vis des fenêtres voisines, éclairées, ouvertes. Allongée, plexus entre les mains, nue, les draps me collent à la peau. Les six mètres cube d’air moite et lourd m’étouffent, je veux lire, je veux la lumière, je veux être nue : je ferme la fenêtre.
L’après-midi, la ville est morte. Ce sont les heures les plus chaudes et les corps suants s’allongent derrière leurs volets, dernier rempart d’ombre. Celle qui s’en va vacante dans les rues est bien le dernier des collages absurdes. Une glace pilée au café, un café, une cigarette, la cigarette dont la fumée se colle. Un peu d’ombre dans une église. Plus tard, les rues s’emplissent, je fais le tour sur les remparts, je vois ces îles au loin auxquelles je rêve. Un parc avec son odeur de guano accumulée, les couches de merde tapissent le sol et les bancs, tous les oiseaux de la côte viennent ici rechercher la fraîcheur des arbres.
Le père enseigne dans une école dont je ne comprends pas le nom ni l’emplacement. Leur maison est grande et fraîche, un jardin. Un balcon long le long du mur, sa vigne où pend des grappes lourdes, ses feuilles étalées. On mange des pâtes sur une grande table avec toute la famille. C’est l’image d’un album d’enfant. Comment vivent les familles dans les différents pays, peut-être, j’ai oublié. J’ai oublié quand ils m’ont déposée près de l’hôtel, faisant un détour pour m’éviter les tracas d’un retour au bercail incertain. La gêne ambiante du silence gêné, la bénédiction de la radio.
Chambre d’hôtel, je mange des tomates, à côté du tube de dentifrice.
-
Parcourir
Parmi les grottes, une est inaccessible, on peut voir de loin que des salades ont poussé au sol, que les murs ont des mousses, qu’elle suinte. Je m’engouffre dans la haute grotte comme une longue fente vers le ciel. C’est la grotte des échos, celle où la voix de dieu surgissait et pétrifiait les désobéissants. Profonde, on y pénètre et entre deux parois proches qui forment une voûte en biseau, on cherche le fond. Là où les murs finissent par se rejoindre et refermer l’espace, la largeur augmente légèrement, pour former une douce arène. Les enfants informés par leurs parents des fonctions utiles de cette grotte testent sa réputation et lancent leurs cris. Cri qu’on n’ose à peine pousser, intimidé, curieux et joueur mais gagné par la prestance des murs humides, insensibles, indifférents, d’un autre temps. Cri de test.Le même cri poussé dans les draps dans l’espace court entre deux murs fins, dans cet espace saturé, dans cet espace écrasé par la masse des habitants compressés autour. Le bruit de la porte pour aller pisser emplit tout l’espace. Mourir d’amour. Abe Sada, Abe Sada, tes petit cris suppliciés, Abe Sada sans lui. Le bruit de ma respiration étouffée essoufflée dans les rues de midi, les oreilles derrière les volets concentrées sur cette respiration qui passe, les rues vite reconnectées, petite ville, petit périmètre, une île, les remparts, les vagues sans baignade, les airs conditionnés.
Pour atteindre les grottes, l’amphithéâtre, les enclaves dans la roche, longer la route à grande vitesse, la station essence, reconfigurer un trottoir fictif, faire le détour nécessaire pour le passage piéton, laisser l’instinct aller dans la bonne direction. Les touristes viennent en car. Là, choisir son aire de visite : le musée, ou les jardins ? Les grottes ou les vestiges ? Longer les stands de souvenir : amphores en toc, sirènes en pastique, horloges suisses. Et derrière les arbres, voilà l’amphithéâtre, et ses chiens. Une meute de chiens pelés, hauts d’un mètre, des couleurs fauve et noir, du marbre, des blessures infectées. Les femelles ont des mamelles gonflées et atrophiées par des cancers, elles sont étalées par terre, l’immobilité en lutte contre la chaleur du soleil. Les mâles, inquiets, se couchent et se lèvent, grondent, longuement, tournent leurs têtes énormes. Des chiens divins, des chiens à hauteur de fauve et à caractère de hyène. Ils surveillent les visiteurs de ce territoire de vestiges, eux qui le considèrent comme leur territoire, là où leurs portées se terrent et là où ils ont répandu leur odeur, leur urine, leurs traces dans la terre sèche et ocre.
Ces hommes perdus sur les plateformes des métros, en stationnement au milieu de leurs humeurs putrides, de leurs derniers haillons dans des sacs éventrés. La jeune fille passe, jupe en lévitation sur des jambes fines, elle enlève son pull en levant ses bras et ses seins, laisse éclater la lumière de ses épaules dans un grand mouvement de chevelure parfumée. Sur le quai d’en face. Le train en vacarme mange son image.
Ces chiens. Les bêtes qui prolifèrent dans le sanctuaire du tourisme ; les autobus de visite guidée. Les pierres alignées, empilées, des gradins, entre elles poussent des herbes sèches éphémères. Le parcours fléché est bordé de cordes rouges, au centre, l’arène est solitaire, désertée par ses fantômes, les vents en petits tourbillons, on prend des photos derrière la corde rouge.
Le désert où l’on s’arrête, après quelques kilomètres sur cette route rectiligne qui le traverse, au bord de cette route, un homme vend des roses des sables. Le car repart.
-
Revenir
Sur cette île il existe des sens uniques : sur cette île certaines routes sont impossibles. Quand deux villes ont trop peu d’importance, on oublie les routes qui les relient, elles disparaissent des cartes et des mémoires, elles disparaissent des possibilités de l’imagination. Elles n’existent plus. La géographie n’est plus celle de la logique, elle devient celle des habitudes, des existences. La route qui relie A de B passe-t-elle le long de la côte ? Zigzague-t-elle le long des flancs de montagnes, passant par des cols et redescendant dans les vallées avec des haut-le-cœur ? Est- ce une ou plusieurs ? La largeur est-elle suffisante pour que deux véhicules se croisent ? Peut-être sûrement que le goudron s’émiette, posé une fois pour toute et laissé en paix.
Mais pour je touriste chose qui a perdu la parole au fil des kilomètres, les grandes étendues de plusieurs heures sans la sécurité pour le sommeil ne s’envisagent pas. C’est la nuit qui brandit son obscurité grouillante. Il y a erreur. Je dépends des trajets autorisés : je dépends des autocars pleins de vieilles qui mâchouillent leur déjeuner emballé dans du papier alu. Pour rejoindre B s’il vous plait ? Ah non, il n’y a pas de bus pour B ! il faut passer par Y ! Y, j’en viens, il est hors de question de rebrousser chemin, ne serait-ce que pour un détour. Et puis quoi, passer encore une nuit à Y, revenir dans l’hôtel minable qui a déjà vu ma solitude ? Le trajet est trop long pour faire en une journée A-Y-B, alors que B est plus proche de A ! Refaire le triangle déjà à demi tracé ? On peut apprendre finalement qu’il y a un bus qui part maintenant, dans une minute, et qui passe par Y où il fait une halte, pour repartir vers B. Il roulera de nuit. On arrivera au petit matin. On arrivera quand on pourra. Je ne sais plus quand on arrivera. Il suffira de ne pas reconnaître Y, il suffira de se laisser glisser au travers d’Y, de n’y voir que la gare routière, de n’y entendre qu’une pause du moteur, d’attendre calmement au chaud le retour du chauffeur. Oui, je vais m’embarquer dans le bus fantôme, pour ne pas reconnaître les lieux et oublier de toutes mes forces ce deuxième parcours. En sens inverse : ce qui coulait sur mon côté arrivera avec fracas devant moi, ce qui fonçait vers moi coulera là-bas. Et j’ai bien oublié, j’ai bien rayé ce retour qui proclamait bien haut ma dépendance aux organisés, ma petite couardise, ma soumission aux trajets officiels. -
Contourner
Préliminaires. Comme un immense sein gris il se dresse sur la plaine. Plaine, péninsule, surface fertilisée par son passé endormi. Un gris moiré, un noir grisé, une pierre a colonisé le sol. Jusqu’à la mer, jusqu’au ralentissement de son flux figé. La circonférence d’étalement, la circonférence de braise. Compter les kilomètres. Les préliminaires visuels, les préliminaires de parcours. Les rails sont en dedans de la limite, parfois la dépassent, celle d’il y a mille ans, celle d’il y a cent ans, celle d’il y a seulement quelques années. Quand les hommes ont reconstruit. A plusieurs point particuliers précisés par l’élévation d’une église, grise, les hommes ont construit au dedans, gris. Rues de sol gris, rues et façades, friable sculpté, gris absorbant, mat absolu, noir grisé, figé. Ils ont une persistance inouïe à habiter.
Plus récent, la pauvreté en un peu moins, la communication en un peu plus, matériaux pacotilles, quantité, rapidité, capacité de renouvellement facilité. A échelle temporelle humaine. Les rails eux sont toujours flexibles et mathématiquement courbes. Parfois, au dedans, ou au dehors, les couches ont absorbé, et des sédiments colorent le terrain, parfois.
La mousse colle le gris. La mousse verte. La mousse, deuxième colonie, bien plus rapide que les humains et bien plus indifférente.
Vert.
Le train, lui, s’arrête à chaque gare. Consciencieusement. Préliminaires. Je fais la cour à celui qui domine la plaine, je deviens masculin, je lui fais la cour, ou je fais la cours à mon approche, je fais la cour au moment. Le moment où j’aurais mes pieds sur lui, mon buste penché en avant pour l’ascension.
J’ai la tête tournée à droite. Assise sur les sièges rouges, dont certains sont éventrés. Des femmes rentrent chez elles après leur travail ou les courses faites à la ville. Leur visage est figé. Comme en deuil. Des visages creusés, travaillés par le soleil, friable sculpté, mat absolu. Le vent siffle sur la tranche des vitres. Voilà le périmètre que je veux voir exclusivement : c’est à droite. Assise dans le sens de la marche.
Le temps noie la circumvolution. Un virage sur la gauche et je perds mon point de vue, ma concentration. Le dôme semble doux d’ici.
Un virage sur la gauche et c’est une échappée vers les reliefs extérieurs. Ils brillent de leurs couleurs incongrues, peaux. Ils sont appel d’air, annonce d’un ailleurs au cercle.
Tout l’intérêt réside dans la boucle effectuée, dans cette demi-journée de trajet autour, à distance calculée, celle des rails à ne pas reconstruire trop souvent, celle des villages subsistants, à distance évaluée à vue d’expériences passées, approximation qui laisse le danger des laves en sourdine seulement. Laves lentes et pluies noires. Seulement, les déferlantes ralenties.Je me laisse porter en avant. Le rythme au-devant approche et repart. Fuite placide. J’aime à être dans le sens inverse de la marche. Je vois au loin disparaître mon lien à lui. Je vois au loin, naturellement, sans effort, se calmer la douleur. Je vois disparaître l’outrageant plaisir de tromper mon visage. Il se laisse tromper, celui qui ne veut rien voir. Lui, il peut essuyer un refus. L’honneur n’est pas perdu. Elle, elle ne peut pas se payer ce luxe. C’est au premier personnage féminin que le spectateur s’identifie. Et c’est cette première femme qui gagnera l’amour du personnage principal. Et des spectateurs. C’est ainsi que se distribuent les rôles. Elle ne sera pas délaissée. On peut vivre ce qu’on ne représente que peu. La laideur de ce rôle impossible vous saute à la gorge. D’où, les sous-entendus, d’où, les aveux inavoués. Dissimuler ou jouer le rôle impossible.
Le jeu sentimental se rejoue dans l’espace, la géographie de ce jeu là ne m’échappera pas.
La courbe n’est pas, peut-être pas encore, construite, bouclée. On a construit et on s‘est arrêté. Pour ceux qui circulent inutilement dans leur après-midi de soleil, il faut rouler sur les routes avec un car spécialisé. Le car rejoint la dernière gare à la première de l’autre côté. Un sixième de cercle peut-être à effectuer en fausse continuité. A certains moments on fait face à la mer. Se demander si le trajet est plus resserré. Si l’activité circulatoire se sent prise entre géant et mer. -
Remonter
Le village sur un monticule en hauteur, qui domine les alentours ondulés. Les vestiges, colonnes, temples, pierres sculptées, s’alignent sur un relief. Il y a des cimetières, des catacombes, par des fenêtres grillagées pour la sécurité de tous, on aperçoit ce monde humide sous la terre. Cette ligne de temples est en contrebas du village, mais elle domine encore le paysage. C’est l’intermédiaire. En bas, quelques routes, des rivières, des prés secs. Des immeubles en construction, des habitats modernes et laids. Sur le coteau, j’ai mal choisi l’heure, le soleil est au dessus. Immense. Immenses colonnes où l’on accède par les marches trop hautes, passer n’importe où là où il y avait des murs, s’échapper de la colossale esplanade par son éventrement latéral, tout est ouvert, les trajectoires ne respectent aucun rituel, aucune entrée, aucune prière. Les vestiges sont bancals, la terre manque sous leurs bases, et des fosses recueillent leurs pierres taillées en vrac, amoncellement en mémoire.
Un statue, allongée, déesse, femme au sexe offert, jambes lourdes et l’épaule, le visage a roulé quelque part.Lui, il collectionne ces rocs qui croisent son chemin. Son musée est infiniment lourd, toujours plus lourd. Rocs, tel est ce corps de femme et vu de ses pieds c’est un roc reposé. Avec lui son jumeau dans cet autre pays, une fente de haut en bas, sur cette pierre masse, carré arrondi.
Plus haut, en remontant sur la route, le musée avec toutes les choses qui sont plus que de simples pierres de construction. Au clair tout est joliment conservé, exposé, expliqué, démontré. Scénographie de gravures, sculptures, vases précieux et pierre précieuse, reconstitutions, bijoux, bols, peignes, miroirs de pierre lisse. Le musée est désert la nuit tombe. Je suis la dernière au milieu des surveillants de salle. Il est trop tard pour le bus.
J’essaie de comprendre ce que me dit la vendeuse de tickets du musée, très réticente à m’expliquer comment rentrer au village. Elle et ses compagnes ne peuvent me regarder directement.
Je sors, noir complet, pas d’arrêt de bus, comme promis, sur la route, vers le village. Pas de lune. Je marche sur cette route sans lampadaire, seuls les phares des voitures m’éclairent, m’éclaboussent aux yeux des conducteurs. Je me vois par eux. Dans l’obscurité je suis intègre, cachée, animale. J’écoute le vent parfois.
Je m’essouffle. Ce souffle. Chaleur à la peau, pas de couleur qui ne se voie mais mon râle. Le corps est bavard. Comme se divise l’espace par cette bande goudronnée, où rien ne s’élève. A sa droite, à sa gauche. A sa droite le vide ou les choses, à sa gauche la pente, montante, et ses choses. Tout ce qui m’entend souffler. Dissimuler ce souffle, le diviser par une large bande de silence, il déborde à droite et à gauche.
Avce les phares je suis un lampion clignotant. Visage/pas de visage.
Découvert tardivement, la farce de la lampe de poche placée sous le menton pour effrayer ne m’a jamais effrayée, ni fait rire.
Visage pour les phares. Les phares sont utilisés par des personnes aux commandes d’une machine, ils leur permettent de voir au devant de cette machine, assez rapidement pour éviter tout obstacle.
Visage.
Je marche sur le sable du bas-côté ; parfois il n’y a pas d’espace où se tenir, je marche sur la route avec des embardées dans les fossés. La route zigzague toujours en montée abrupte, je frôle arbres et cactus. J’ai soif. Autonomie.
Enfin j’atteins une place, des immeubles, c’est le bas du village, géographiquement et socialement. Je demande mon chemin à une vieille bien choisie par mes soins, elle sursaute de ce frais fantôme. Jusqu’ici une seule route menait vers le haut, mais quand arrivent les places et les ruelles, et les lampadaires, les embranchements foisonnent. La route hors des murs pointait droit vers son but, à présent les rues choisissent toutes de contourner la pente.
Des escaliers raides, couper court, des impasses, l’instinct dit : toujours monter.
Enfin la place aperçue ce matin, me revoilà dans le plan. -
Suivre
Pente lente jusqu’à la mer, pente à compter en heures. Grande pente aride et rèche mais verte cependant avec le temps, grande pente vers la mer. Douze et quinze et quarante blocs en bloc avec la terre, seize blocs à compter en heures vers la mer. Tranchées où caché, les épaules et les couches de cendre si en découpant il a scié des crânes aussi et certaines balançoires et des murs calcinés. Si en marchant du matin au soir il a vu des crânes déjà ramassés par eux, s’il a vu le creux du crâne ramassé. S’il a vu les couleurs des cendres rouges, des cendres froides, des cendres grises, et le temps qu’elles ont mis à tomber. Et l’ombre, elle, qu’on force à se porter, verticalement, ou jamais, peut-être, au creux.
Les fossiles de la maison des sables, l’histoire de la femme des sables, sous-jacente, pétrifiée.