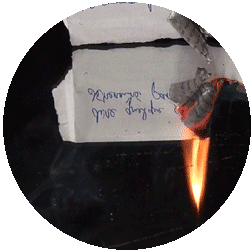Quand on descend, on marche vite, les jambes lancées, l’action c’est de rattraper le corps, on joue avec le poids, l’attraction terrestre. Si ce n’est pas la bonne route, il va falloir remonter, impossible. Soleil. J’ai oublié de prendre un chapeau, ou un foulard, les cheveux brûlants.
L’hésitation, de temps en temps une voiture, je lève le pouce. Une étrangère, ça saute aux yeux. Montrer un visage tout-va-bien. Tout va bien, c’est le début de la journée, il reste beaucoup d’heures pour agir.
Quand une voiture s’arrête, je le regrette presque, un vieil homme seul, regard de travers. Il me parle de ses enfants. Vieux outils qui traînent dans la voiture, blanche, une petite camionnette. Je crois qu’il ne regarde pas assez du côté de la route, ses lunettes collent de saleté.
On roule, j’y aurais passé la journée si j’avais continué à pied. Toujours en descente. Un village soudain devant lui et devant moi. C’est là, c’est là, il pointe du doigt. Au revoir, merci et bonne journée.
De quel côté ? Je prolonge dans la même direction, petit chemin humide. Trouver l’eau, trouver son bruit. Le chemin s’effiloche, peu de chance. Je reviens sur mes pas. Un autre, marcher, être patiente. Oui, je vois, des voitures garées, une aire faite pour ça. Sorte de hutte qui nous dit que c’est là. Des familles quittent leur voiture, pique-nique, couvertures et maillots de bain. Suivre le flux, déjà éparpillé. La route est de sable, large, chemin aménagé. On ne descend plus. Voici l’entrée du tunnel qui mène aux gorges.
Ce tunnel semble tout frais. Tout frais construit. Les chaussures des petits groupes qui vont vers leur journée de détente au bord du torrent crissent sur le gros sable de la route. Des fuites de temps à autre, un tunnel très peu authentique, fait pour les nouveaux touristes.
A l’autre bout, la chaleur m’écrase. La route s’étrécit. Elle longe le flanc d’un mont gauche. En contrebas, le torrent, inaudible et invisible d’ici. Encore plusieurs mètres et la route abandonne ses velléités touristiques. Devient plus accidentée. En descente, et on a accès au torrent qui passe. Des criques reposent l’eau et c’est là que les familles choisissent de s’installer. L’eau est dense et froide mais le soleil chauffe l’enclave comme un four.
Jaune craie, ocre pâle, la roche, peu de végétation. La verdure entoure le torrent comme des poils un sexe. La roche est polie et creusée, il y a des grottes. Je cherche l’endroit ou me reposer, me baigner. Chercher la pierre plate accueillante, cachée, au bord d’un creux d’eau un peu plus large. Pas trop près des familles, pas trop isolé.
Là, il y l’endroit parfait. Mais comment s’arrêter là ? La vallée est longue. Je n’ai pas vu encore les tombes troglodytes.
Ils pouvaient escalader habilement les parois. Les Anasazis étaient ici. Vivaient de chasse et de cueillette, cultivaient des légumes et des fruits sur les étroits coteaux.
Le chemin joue un jeu d’amour avec le torrent, venant le caresser puis s’éloignant haut dans la paroi, passant dans les infractuosités de la roche. Je cherche les ruches préhistoriques dans le flan opposé, me trouant les yeux, croyant être aveugle. Bientôt, elles apparaissent, les cases, nettes et précises, évidentes, en altitude.
Les promeneurs d’aujourd’hui ne peuvent pas y monter, ils restent sur leur chemin à les imaginer de plus près, leurs plafonds bas, leurs nivellements : cette roche bossue était une table. Leurs lits en creux.
Voilà les troglodytes. Une trentaine de petits trous dans la roche, là haut. Vu d’ici, en contrebas, dans le four.
La bête me pousse et mon pas est rapide. Le chemin passe de l’autre côté du torrent. Les vergers apparaissent, en rangées, plantés là sur d’étroites surfaces approximativement planes. A ce niveau de la vallée le chemin s’est élargi à nouveau, il peut permettre à d’éventuels véhicules d’accéder à l’enclave. La zone de loisir est derrière moi. Pourtant bientôt une aire de pique-nique, fantomatique, de ces fantômes vaporeux et brûlant, de ce délire de transpiration. Tables rondes en pierre, encerclées de bancs solidaires, en pierre eux aussi. Plus d’une heure déjà que les babillages des plaisanciers sont étouffés par la distance et les replis de la roche. Quand et où finit cette vallée ? En ressortir à l’autre extrémité. La soif me tiraille devant l’eau qu’il ne faudrait pas boire. Il ne faut pas, concentrée sur le goût de la rivière pour ne pas m’empoisonner. Sur son lit, galets et cailloux. Je cherche un galet lisse. Je cherche un coin un peu plus caché par les arbres. Je cherche un creux.
Il est temps pour, ailleurs, un moment de baignade, pour y penser, aux possibilités de retour à l’hôtel,
Des points noirs, gonflés, dans les buissons, les ronces, des mûres. Leur goût comme un bijou. Je suis survivante ici, seule, avec ces mûres. Chaque saison son fruit. Je fabriquerais une canne à pêche. Peut-être même un arc pour chasser.
Ce lieu pour disparaître.
Sur le retour, une grande pierre au-dessus d’un bassin. S’enfoncer dans l’eau progressivement. Son froid dense presse, mordant. Puis, le corps habitué, grimper sur la roche et sauter, s’engloutir brusquement. Plusieurs fois. La crique est profonde, on voit jusqu’au fond, un poisson.
Le corps verrouillé, une angoisse sourde dans la nuque.
Je suis là un élément indépendant et séparé dans ce décor, et surtout sans moyen de transport, cet handicap faisant de moi une chose importée, un collage.
Je guette l’heure de départ des villégiateurs, seul espoir pour moi de rejoindre le village le plus proche, peut-être un bus. Les quelques familles semblent s’être donné le mot pour évacuer la zone, et dans un mouvement migrateur je les suis. En marchant, j’observe les différents petits groupes, jaugeant mes chances de monter dans leur carrosse. Tel troupeau est trop nombreux : un couple et quatre enfants, il n’y aura pas de place pour moi. Tel autre s’effraiera : deux vieux très méfiants. Arrivés à l’aire de parking, où attendent, bien rôties, les quatre ou cinq voitures, tout va très vite, les marmots embarquent, le père fait tourner la clé. Dernière chance précipitée, tentative d’approche d’une dame, qui sera bienveillante, il faut l’espérer. A force de mauvais accent anglais, de mots-clés italiens et de gestes embarrassés, elle comprend enfin que j’aurais bien besoin d’un tour en voiture.
Me voilà embarquée avec un couple grisonnant et leur fils ado attardé, lubrique et bourré de tics.
La proie que des parents sadiques et incestueux voudraient offrir à leur fils psychotique.
L’hôtel est en périphérie de Syracuse. Proche de la gare routière, les chambres sont les moins chères que l’on peut trouver. Entre mon lit et le lavabo où je lave les tomates du dîner, il y a cinquante centimètres. Un liseré de carrelage vert borde cet espace délimité, espace d’eau. Il y a la fenêtre qui donne sur la cour, en vis à vis des fenêtres voisines, éclairées, ouvertes. Allongée, plexus entre les mains, nue, les draps me collent à la peau. Les six mètres cube d’air moite et lourd m’étouffent, je veux lire, je veux la lumière, je veux être nue : je ferme la fenêtre.
L’après-midi, la ville est morte. Ce sont les heures les plus chaudes et les corps suants s’allongent derrière leurs volets, dernier rempart d’ombre. Celle qui s’en va vacante dans les rues est bien le dernier des collages absurdes. Une glace pilée au café, un café, une cigarette, la cigarette dont la fumée se colle. Un peu d’ombre dans une église. Plus tard, les rues s’emplissent, je fais le tour sur les remparts, je vois ces îles au loin auxquelles je rêve. Un parc avec son odeur de guano accumulée, les couches de merde tapissent le sol et les bancs, tous les oiseaux de la côte viennent ici rechercher la fraîcheur des arbres.
Le père enseigne dans une école dont je ne comprends pas le nom ni l’emplacement. Leur maison est grande et fraîche, un jardin. Un balcon long le long du mur, sa vigne où pend des grappes lourdes, ses feuilles étalées. On mange des pâtes sur une grande table avec toute la famille. C’est l’image d’un album d’enfant. Comment vivent les familles dans les différents pays, peut-être, j’ai oublié. J’ai oublié quand ils m’ont déposée près de l’hôtel, faisant un détour pour m’éviter les tracas d’un retour au bercail incertain. La gêne ambiante du silence gêné, la bénédiction de la radio.
Chambre d’hôtel, je mange des tomates, à côté du tube de dentifrice.